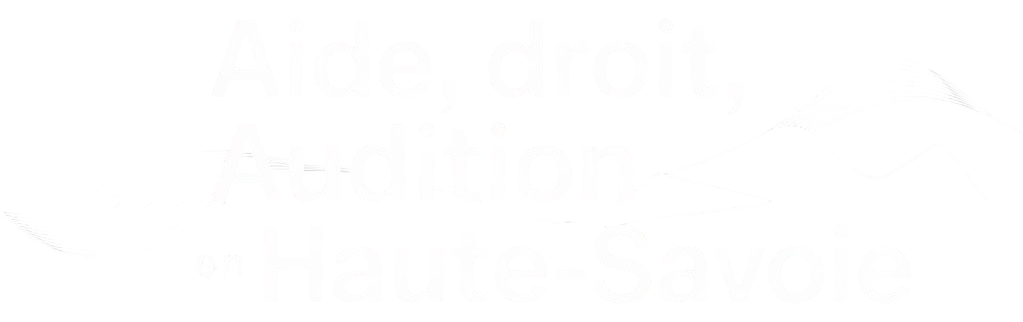Pourquoi dépister la surdité dès la naissance ?
Chaque année en France, environ 800 enfants naissent avec une surdité profonde ou sévère bilatérale, soit environ 1 naissance sur 1000 (source : Haute Autorité de Santé, HAS). Si on inclut les surdités modérées ou unilatérales, le chiffre approche 1 à 2 enfants pour 1000. Ce handicap invisible peut avoir des conséquences majeures sur l’acquisition du langage oral, la scolarité et l’épanouissement personnel.
La plasticité cérébrale du tout-petit permet, grâce à une stimulation adaptée, d’offrir les meilleures chances de développement. D’où l’importance capitale de diagnostiquer les troubles auditifs avant l’âge de six mois. Un dépistage tardif, au-delà d’un an, entraîne souvent des retards de langage importants, plus difficiles à rattraper.
- Communication précoce : Un enfant appareillé tôt pourra apprendre à communiquer plus facilement, que ce soit par la parole ou par la langue des signes.
- Soutien à la parentalité : Les familles accèdent plus vite à un accompagnement, des professionnels, et rencontrent d’autres parents, ce qui réduit l’isolement.
- Meilleur développement global : Le dépistage et la prise en charge précoce favorisent l’inclusion sociale, scolaire et professionnelle de la personne sourde.