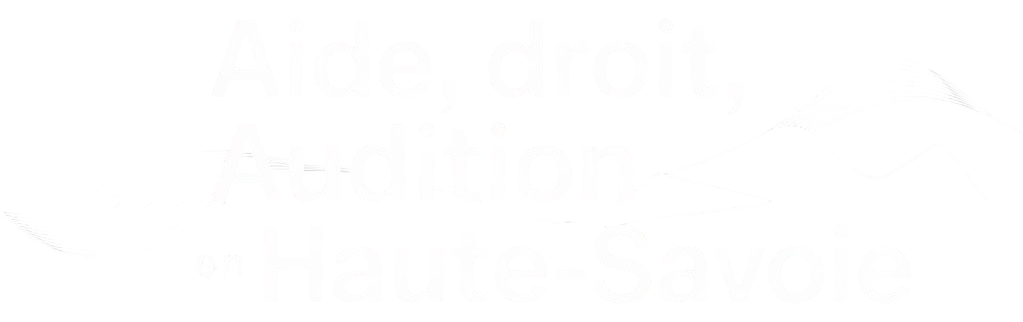Les principaux examens médicaux pour diagnostiquer une surdité
1. Le dépistage néonatal de la surdité
Depuis 2012, le dépistage de la surdité est généralisé à la naissance dans les maternités françaises. Deux tests non-invasifs et indolores sont utilisés :
- Otoémissions acoustiques (OEA) : Elles consistent à mesurer la réponse de l’oreille interne à un souffle sonore. Si les OEA sont présentes, l’audition est a priori normale. Ce test prend quelques minutes, pendant que le bébé dort.
- Potentiels évoqués auditifs automatisés (PEAA) : Si les OEA sont absentes ou douteuses, les PEAA vérifient la bonne transmission du signal sonore jusqu’au cerveau. De petits électrodes sont posés sur le crâne et l’oreille. Cet examen objective les troubles auditifs chez le nouveau-né (source : Ministère de la Santé).
Selon la Fédération Nationale des Sourds de France, en 2021, près de 825 000 bébés ont ainsi été dépistés, avec un taux de détection d’une surdité profonde autour de 1,5 pour 1000 naissances (FNSF).
2. Examen clinique et entretien
Quelle que soit l’âge, le médecin ORL commence par une observation clinique :
- Recherche de bouchon de cérumen, infection ou malformation de l’oreille
- Entretien avec la famille (antécédents familiaux, grossesse, maladies, facteurs de risques…)
- Observation du comportement auditif
Ce premier bilan guide le choix des examens suivants.
3. L'audiométrie
L’audiométrie est la pierre angulaire du diagnostic chez l’enfant et l’adulte.
-
Audiométrie tonale (subjective) :
- Le patient se trouve dans une cabine insonorisée ; il répond (bouton, geste) quand il entend des sons de différentes fréquences et intensités présentés par un casque.
- L’audiogramme obtenu permet d’estimer la perte auditive, de chaque oreille, en décibels (dB).
Une audition normale se situe entre -10 et 20 dB. Les seuils de déficience auditive sont fixés à 20 dB ou plus (OMS : OMS 2021).
-
Audiométrie vocale :
- Évaluation de la capacité à comprendre la parole (dans le silence ou dans le bruit) : répétition de listes de mots à différents volumes.
La compréhension est parfois altérée dès les pertes légères, d’où l’importance de compléter les tests purement “sonores”.
4. Les examens objectifs de l'audition
Certains tests permettent de mesurer l’audition en dehors de toute participation active, particulièrement utiles chez le jeune enfant, les personnes non-verbales ou en situation de handicap.
-
Otoémissions acoustiques (OEA) : (Voir partie dépistage néonatal)
-
Potentiels évoqués auditifs (PEA ou BERA) : Mesurent l’activité électrique du cerveau en réponse à un son. Ils précisent le seuil auditif réel, la localisation de la lésion (oreille moyenne, interne, voie nerveuse) et sont incontournables dans l’évaluation des surdités profondes ou rétrocochléaires.
- Ils peuvent être automatisés (“screening”) ou conventionnels (plus complet, réalisé en centre spécialisé, souvent sous légère sédation).
-
Impedancemétrie (ou tympanométrie) : Vérifie l’état du tympan et la mobilité de la chaîne des osselets. Sert principalement à différencier une surdité de transmission (pouvant être corrigée : otite, bouchon…) d’une surdité neurosensorielle.
5. Examens complémentaires selon la situation
Lorsque le bilan de base confirme ou suspecte une surdité, d’autres explorations sont possibles pour guider le traitement ou comprendre la cause.
-
Bilan génétique : Jusqu'à 60 % des surdités congénitales seraient d'origine génétique (source : ORPHANET). Une consultation génétique est alors proposée, pour compléter le diagnostic, anticiper d’autres retentissements ou accompagner les familles.
-
Imagerie médicale : Un scanner ou une IRM de l’oreille interne et du cerveau peuvent être nécessaires en cas de malformation, suspicion de tumeur, ou de surdité unilatérale soudaine.
-
Bilan vestibulaire : Si des troubles de l’équilibre accompagnent la perte auditive, des tests spécifiques étudient l’appareil vestibulaire.
-
D’autres bilans : (sanguins, électrocardiogramme, examens ophtalmologiques…) selon le contexte, notamment en cas de surdité associée à d’autres anomalies (“syndromiques”).
Plusieurs hôpitaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes, notamment à Lyon et Grenoble, disposent de services d’exploration auditive avancée adaptés aux enfants et adultes sourds (source : CHU Lyon).