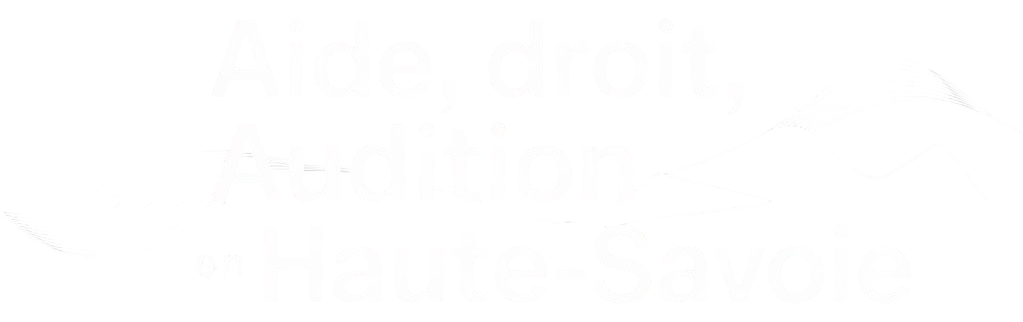Impact sur la communication et le développement
Pour les enfants sourds de naissance : la question cruciale du langage
Lorsqu’un enfant naît sourd ou malentendant, la question de l’accès au langage se pose d’emblée : car entendre, c’est la voie principale par laquelle on acquiert la langue parlée. L’accompagnement précoce et le choix du mode de communication (langue des signes, LPC, implants cochléaires, appareillage, oralisation seule ou en combinaison…) vont directement impacter le développement langagier et cognitif.
- Sans prise en charge adaptée, on observe un risque de retard dans l’acquisition du langage parlé, du vocabulaire et de la lecture.
- L’accès à la langue des signes française (LSF), précoce, joue un rôle fondamental pour de nombreux enfants, tant sur le plan de la communication que de la structuration du raisonnement (FISAF).
En cas de surdité acquise : l’enjeu de la réadaptation
Chez l’enfant entendant devenu sourd, il existe déjà une base langagière orale. L’enjeu va alors être la préservation de cette base et l’ajustement des stratégies de communication (lecture labiale, français signé, recours aux outils électroniques…). L’adaptation psychologique occupe ici une place centrale.
Pour l’adulte, le bouleversement est souvent vécu comme une rupture : sentiment d’exclusion, d’isolement social, difficulté à conserver son emploi... Selon un rapport de l’ANAP, jusqu’à 60 % des adultes perdant l’audition signalent des répercussions fortes sur la vie professionnelle et sociale.