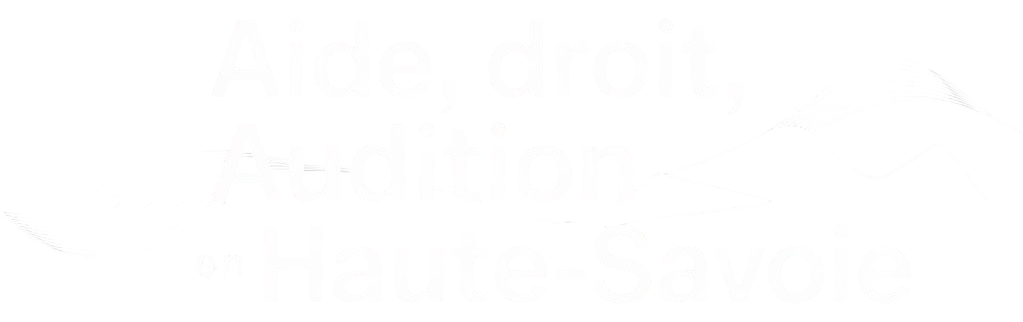Dépistage et diagnostic de la surdité : quelle fiabilité ?
Dépistage à la maternité : une étape clé
Depuis 2012, le dépistage néonatal de la surdité est proposé dans toutes les maternités françaises : un test objectif, rapide, sans douleur (otoémissions acoustiques ou PEA). Cette mesure détecte 90 % des surdités sévères ou profondes de naissance (source : Haute Autorité de Santé). Le test n’affirme pas toujours une surdité : il signale un doute, à confirmer par des examens spécialisés.
- Les otoémissions acoustiques (OEA) : Permettent de vérifier l’intégrité de la cochlée.
- Potentiels évoqués auditifs (PEA) : Mesurent la conduction nerveuse du son jusqu’au cerveau.
Des tests complémentaires sont nécessaires en cas de doute ou de facteurs de risque : prématurité, antécédents familiaux, infections durant la grossesse.
Le parcours du diagnostic détaillé
Si une suspicion de surdité est posée lors du dépistage, un parcours précis s’engage :
- Consultation ORL pédiatrique ou adultes : Interrogatoire médical, antécédents familiaux, observations comportementales.
- Examens audiométriques :
- Audiométrie comportementale : On observe la réaction de l’enfant à différents sons (jeunes enfants : attention portée, sursaut, orientation). Pour les plus de 5 ans, audiogramme conventionnel.
- Tests électrophysiologiques : PEA, OEA, potentiels d’action du nerf auditif.
- Imagerie : IRM parfois pour explorer l’oreille interne, rechercher une malformation ou une atteinte neurologique.
- Bilan génétique : Si suspicion d’origine génétique, test sanguin proposé (avec consentement parental chez l’enfant).
- Bilan pluridisciplinaire : Orthophoniste, psychomotricien, autres spécialistes selon les résultats et besoins de l’enfant ou de la personne adulte.
- Annonce du diagnostic : L’accompagnement et le soutien psychologique lors de l’annonce demeurent essentiels, de nombreuses familles relatant le choc et la sidération (cf. Enquête de l’UNAPEDA).