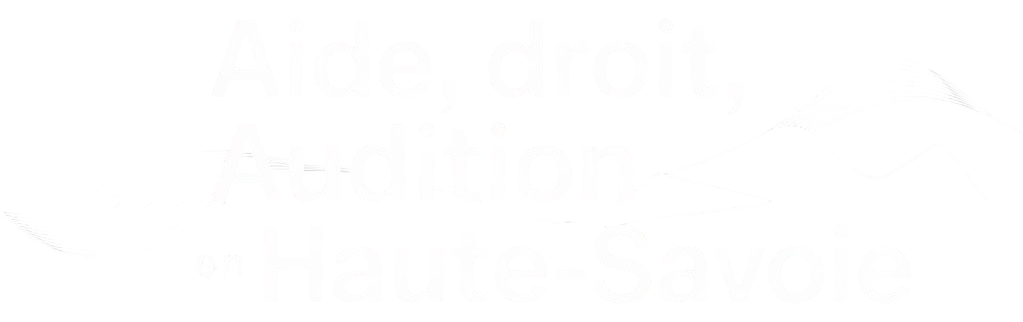Le dépistage auditif : un test rapide pour repérer un risque
Le dépistage auditif occupe une place centrale dans la prévention des troubles de l’audition. Son ambition n’est pas de poser un diagnostic définitif, mais d’identifier le plus tôt possible, souvent de manière systématique, des signes pouvant évoquer une déficience auditive. Comment fonctionne-t-il en pratique ? Qui concerne-t-il ? Quels sont ses avantages et ses limites ? Tous ces éléments méritent une attention particulière.
Qu’est-ce qu’un dépistage auditif ?
Le dépistage auditif consiste en une série de tests rapides, très majoritairement automatisés ou standardisés, réalisés à l’échelle de grandes populations : nouveau-nés, enfants scolarisés, personnes âgées… Il intervient :
- Dans les maternités : Pour les nouveau-nés, le test est proposé depuis 2012 systématiquement à la maternité (source : Ministère de la Santé).
- Lors de bilans scolaires : Un test d’audition est en principe réalisé à l’entrée en maternelle pour détecter d’éventuelles surdités légères.
- En entreprise ou chez le médecin généraliste : Chez l’adulte, notamment lors de suivis santé.
L’objectif du dépistage ? Repérer un signe d’appel ou une suspicion de trouble, nécessitant des examens plus approfondis.
Comment se passe un dépistage auditif ?
- Pour les bébés : Deux méthodes sont principales :
- Les otoémissions acoustiques (OEA) : un petit embout-émetteur placé dans l’oreille mesure la réponse de la cochlée à un son. Ce test dure moins de 5 minutes, est totalement indolore et ne demande aucune réponse de l’enfant.
- Les potentiels évoqués auditifs automatisés (PEA-A) : des électrodes posées sur la tête mesurent la réponse du cerveau à des stimuli sonores. Utilisé si le premier test n’est pas concluant.
- Pour les enfants plus grands et les adultes :
- Le test consiste souvent à reconnaître ou réagir à des sons envoyés au casque, à différentes fréquences. Il est parfois réalisé en milieu scolaire par l’infirmière.
Le résultat du dépistage se résume en deux possibilités : pas d’anomalie détectée, ou suspicion de trouble nécessitant des investigations complémentaires.
Points forts et points d’attention du dépistage auditif
- Points forts :
- Accessibilité : rapide, non invasif, réalisable partout.
- Détection précoce : permet une orientation rapide en cas de problème, facteur clé pour le développement du langage chez l’enfant (Haute Autorité de Santé).
- Coût modéré : processus industrialisé mobilisant peu de moyens techniques.
- Limites :
- Ne diagnostique pas la surdité, mais indique un éventuel problème.
- Peut donner de “faux positifs” (problème signalé alors qu’il n’existe pas) ou “faux négatifs” (trouble non détecté).
- N’identifie pas la cause ni la nature du trouble : surdité de conduction ? Surdité neurosensorielle ? Hypoacousie passagère ?