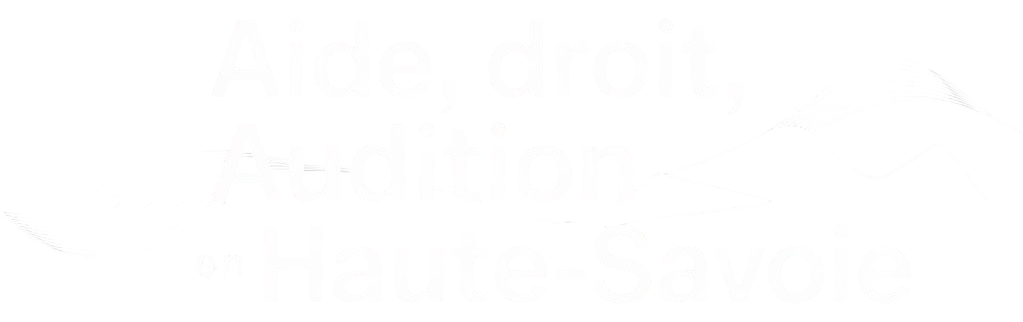Impacts et vécus : conséquences au quotidien
L’impact des surdités temporaires
Un des enjeux majeurs de la surdité temporaire est son impact silencieux sur le langage et l’apprentissage. Un enfant souffrant d’otites à répétition peut, sans que cela soit visible immédiatement, présenter un retard dans l’acquisition du vocabulaire. Une enquête menée dans le canton de Genève (2018) a montré que 37% des enfants suivis pour des otites séreuses prolongées avaient besoin d’un appui temporaire en langage au CP.
Chez l’adulte, une surdité temporaire, même brève, peut générer frustration, anxiété, incidents de communication et gêne sociale. Si l’impact disparaît avec la guérison, un dépistage trop tardif expose à des séquelles inattendues, y compris sur le plan professionnel.
L’impact des surdités permanentes
- Difficultés scolaires persistantes si le diagnostic est tardif
- Risques d’isolement social chez l’adolescent et l’adulte
- Obstacles à l’emploi : selon l’INSEE, seuls 43% des personnes sourdes ou malentendantes ont un emploi contre 64% pour l’ensemble des personnes en situation de handicap (étude 2022)
- Fatigue cognitive accrue, dépression, estime de soi fragilisée, surtout en l’absence d’accompagnement adapté
Pour les jeunes enfants, la précocité de la mise en place de stratégies de communication (langue des signes, orthophonie, visualisation du langage…) change radicalement la trajectoire scolaire et sociale, ce que souligne l’UNESCO dans son rapport de 2020.