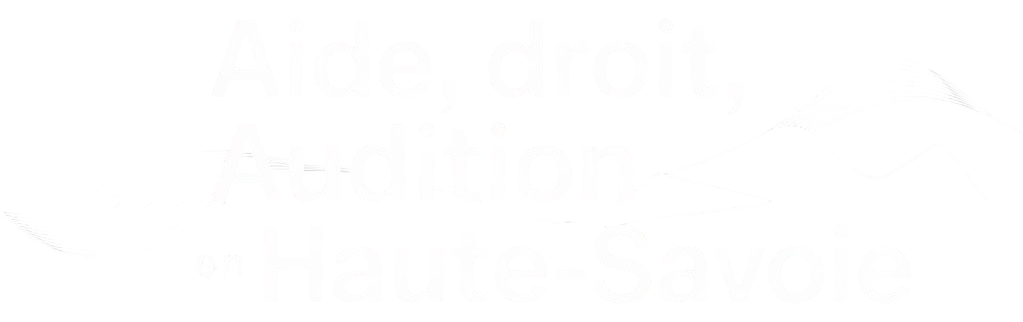Perspectives et enjeux pour un meilleur accompagnement
La compréhension de la latéralité d’une surdité n’est pas qu’une considération technique : elle conditionne le vécu, l’intégration, et parfois l’épanouissement scolaire et professionnel de la personne. Si la surdité bilatérale est souvent identifiée et prise en charge tôt, la surdité unilatérale, moins visible et pourtant tout aussi invalidante dans certains contextes, mérite une vigilance particulière de la part des familles comme des institutions.
Les progrès des dépistages néonataux (généralisés depuis 2012 en France), la disponibilité croissante des aides techniques, l’accent sur la formation des professionnels, mais aussi l’engagement des associations locales et nationales, ouvrent de nouveaux horizons pour les personnes concernées et leurs proches.
Que l’on soit touché de près ou de loin, mieux différencier une surdité unilatérale d’une surdité bilatérale, c’est s’armer collectivement pour proposer un environnement plus équitable et inclusif, en Haute-Savoie comme partout ailleurs.
Sources : Organisation mondiale de la Santé (2021) ; Santé publique France (2023) ; Drees (2021) ; HAS (2020) ; Orl France ; Circulaires Éducation nationale ; Assurance Prévention routière ; Réseau Surdité 74.