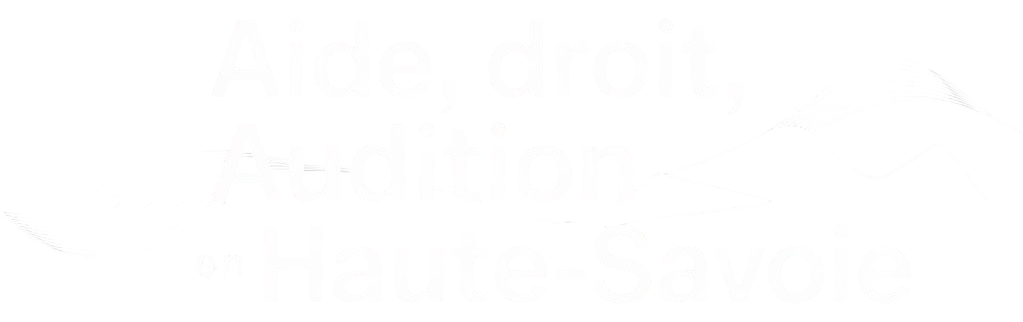Les mécanismes de la surdité génétique : comprendre les formes principales
La surdité non syndromique
La majorité des surdités génétiques sont dites « non syndromiques » : elles touchent uniquement l’audition, sans autre signe associé. Dans ce groupe, la transmission (de parent à enfant) peut suivre différents schémas :
- Transmission autosomique récessive (environ 75% des cas) : chaque parent porte une mutation sur un même gène sans être lui-même atteint. L’enfant doit hériter des deux copies mutées pour présenter la surdité. À titre d’exemple, le gène GJB2 (codant pour la connexine 26) est responsable d’environ 50% des cas de surdité congénitale autosomique récessive en Europe (Orphanet).
- Transmission autosomique dominante : un seul parent peut transmettre la mutation et la surdité concerne souvent plusieurs générations. Cette forme représente 15 à 20% des cas.
- Transmission liée à l’X : plus rare, cette forme touche principalement les garçons lorsque la mutation est portée sur le chromosome X.
La surdité syndromique
Dans 20 à 30% des cas génétiques, la surdité s’accompagne d’autres troubles : vision, troubles cardiaques, atteintes rénales… On parle alors de « syndrome génétique ». Parmi les syndromes connus :
- Syndrome de Pendred : association à une atteinte de la thyroïde et des malformations de l’oreille interne.
- Syndrome de Waardenburg : marquée par des particularités de la couleur des yeux, des cheveux, parfois une hypopigmentation de la peau.
- Syndrome d’Usher : surdité congénitale avec apparition progressive d’une atteinte visuelle (rétinite pigmentaire).
Le repérage précoce de ces syndromes est essentiel pour anticiper l’accompagnement adapté et informer correctement la famille.