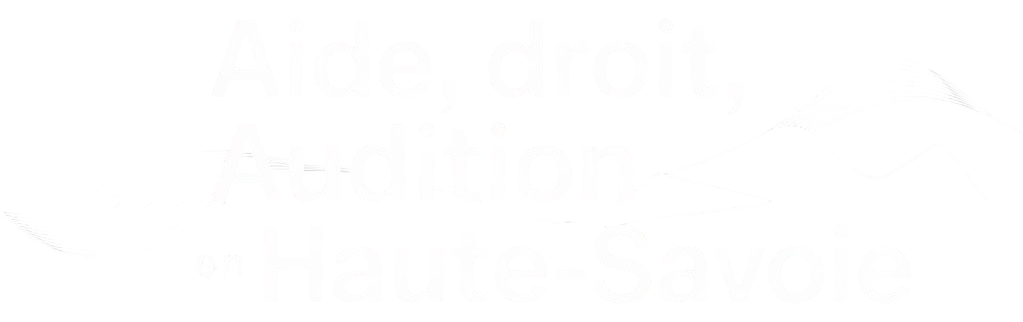Surdité légère : comprendre le quotidien invisible
Une perte auditive discrète, mais source de difficultés
La surdité légère passe souvent inaperçue : beaucoup d’enfants et d’adultes compensent naturellement. Pourtant, elle peut entraîner :
- Un besoin de faire répéter, surtout dans le bruit ;
- Des troubles d’attention, une fatigue accrue ou un retrait social discret ;
- Des difficultés d’apprentissage (notamment chez l’enfant).
Selon l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (Inserm), la surdité légère touche près de 6% des enfants en France ; chez l’adulte de plus de 65 ans, ce chiffre grimpe nettement à plus de 30% (source : Inserm).
Impacts scolaires et professionnels : une vigilance à cultiver
Chez l’enfant, la surdité légère peut passer inaperçue pendant des mois, voire des années. Selon l’Assurance Maladie, environ 30 % des enfants présentant un trouble auditif léger ne sont pas dépistés avant le CP. Cela peut entraîner des retards de langage, voire des difficultés dans l’apprentissage de la lecture.
Au travail, elle peut compliquer les interactions en réunions, surtout dans le bruit de fond ou en cas de communication à distance. Un rapport du Centre d’Information sur la Surdité met en avant que 1 actif sur 10 avec une perte légère ressent des gênes significatives lors des conversations téléphoniques, mais n’ose pas toujours en parler.